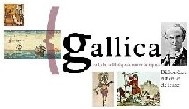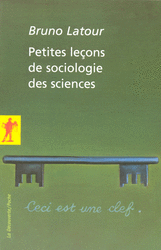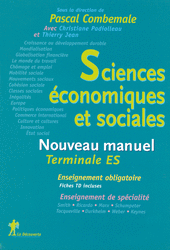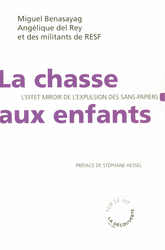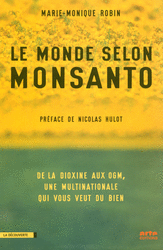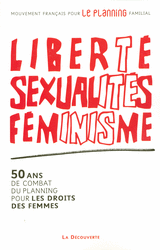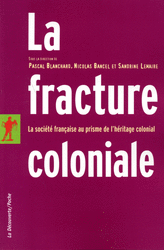Archives
(3352 archives)par François Gèze (directeur des Éditions La Découverte)
Michel Valensi, patron des (excellentes) Éditions de L'Eclat, a publié le 1er novembre 2008 sur son site un texte virulent, intitulé « Marchands de bits » et mettant en cause les conditions de développement de l'offre de livres électroniques des éditeurs sur le site Gallica 2 de la Bibliothèque nationale de France. En radical désaccord avec ce point de vue et en tant qu'acteur direct de cette initiative, François Gèze lui répond ici, point par point.
Le prix Nobel d'économie a été attribué à l'Américain Paul Krugman, 55 ans, économiste spécialiste des échanges commerciaux et éditorialiste au vitriol contre l'administration Bush. Il a publié aux Éditions La Découverte, La mondialisation n'est pas coupable.
Dans L'Atelier des idées neuves
Maître de conférences en sciences politiques, Laurent Bonelli analyse les discours publics sur le maintien de l'ordre et la répression. Ce chercheur de 38 ans a co-dirigé avec Didier Bigo et Thomas Deltombe, un ouvrage collectif intitulé Au nom du 11-Septembre... Les démocraties à l'épreuve de l'antiterrorisme.
En 2008, Bruno Latour, directeur scientifique de Sciences Po, a été élu membre de l'American Academy of Arts and Sciences des États Unis située à Cambridge et fondée en 1780.
Il a également reçu un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal. Enfin, il a reçu la médaille d'honneur de l'Institute for Advanced Studies de l'Université de Bologne décernée pour la seconde fois.
Bruno Latour vient également de recevoir le prix littéraire allemand Siegfried Unseld pour l'ensemble de son œuvre. Ce prix de 50 000€, attribué tous les deux ans par la Siegfried Unseld Stiftung, lui sera remis à Francfort le 28 septembre. Le premier lauréat du Siegfried-Unseld-Preis était Peter Handke.
Nouveau Manuel de SES
Vous êtes professeur de SES en Terminale et vous souhaitez recevoir un specimen de notre manuel : téléchargez ce bon de commande, complétez-le et renvoyez-le à l'adresse indiquée.
Pour plus de renseignements sur le Nouveau Manuel, c'est ici.
Vous êtes professeur de Terminale ES et vous avez déjà votre code d'accès, connectez-vous ici au Livre du professeur en ligne.
La chasse aux enfants Miguel Benansayag, Angélique Del Rey et les membres de RESF
Cet ouvrage est un signal d’alarme lancé par les philosophes Miguel Benasayag et Angélique del Rey, et des membres du Réseau Éducation sans frontières (RESF), confrontés quotidiennement à la réalité de la traque des sans-papiers et de leurs enfants scolarisés en France. Il montre que la politique discriminatoire dont ces derniers sont l’objet a des conséquences beaucoup plus profondes qu’il n’y paraît, puisque c’est la société tout entière qui est traumatisée quand elle est amputée de certains de ses membres : les violences faites aux migrants étant des atteintes à ce qu’ils sont et non à ce qu’ils font, elles provoquent de profonds chocs psychologiques.
Cela vaut en particulier pour les camarades de classe des « enfants chassés », confrontés à d’insupportables contradictions quand les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité sont bafouées au nom d’une certaine conception de l’ordre et de la tranquillité sociale, lorsque des enseignants, des responsables d’établissements ou des parents doivent s’opposer ouvertement aux agents de la force publique qui procèdent aux arrestations ou aux expulsions, quand l’autorité scolaire ou parentale doit contredire une autorité censée assurer la sécurité de tous.
Nourri de nombreux témoignages sur les violences de la « chasse aux enfants » et l’engagement de militants de RESF, ce livre montre que cet eongagement au nom de la solidarité active, maintenant pénalisée, relève, au-delà de la conscience morale, beaucoup plus fondamentalement de la possibilité réelle de vivre ensemble.
Pour en savoir plus sur cet ouvrage
Pour en savoir plus sur RESF
![]()
Le monde selon Monsanto
L'enquête exceptionnelle de Marie-Monique Robin sur le géant industriel vient d'être publiée par la maison d'édition américaine The New Press.
Petit rappel de la sortie de l'ouvrage et du film de Marie-Monique Robin.
Fruit d’une enquête exceptionnelle de trois ans sur trois continents, ce livre reconstitue la genèse d’un empire industriel, qui, à grand renfort de rapports mensongers, de collusion avec l’administration nord-américaine, de pressions et tentatives de corruption, est devenu l’un des premiers semenciers de la planète.
Il paraît en parallèle de la diffusion d'un documentaire exceptionnel, réalisé par l'auteur et produit par Arte (diffusion le 11 mars 2008 à 20h30).
Implantée dans quarante-six pays, Monsanto est devenue le leader mondial des OGM, mais aussi l’une des entreprises les plus controversées de l’histoire industrielle avec la production de PCB (pyralène), d’herbicides dévastateurs (comme l’agent orange pendant la guerre du Viêt-nam) ou d’hormones de croissance bovine et laitière (interdites en Europe).
Depuis sa création en 1901, la firme a accumulé les procès en raison de la toxicité de ses produits, mais se présente aujourd’hui comme une entreprise des « sciences de la vie », convertie aux vertus du développement durable. Grâce à la commercialisation de semences transgéniques, elle prétend vouloir faire reculer les limites des écosystèmes pour le bien de l’humanité. Qu’en est-il exactement ? Quels sont les objectifs de cette entreprise, qui, après avoir longtemps négligé les impacts écologiques et humains de ses activités, s’intéresse tout à coup au problème de la faim dans le monde au point de se donner des allures d’organisation humanitaire ?
Fruit d’une enquête exceptionnelle de trois ans qui a conduit Marie-Monique Robin sur trois continents (Amérique du Nord et du Sud, Europe et Asie), ce livre retrace l’histoire fort mal connue de la compagnie de Saint-Louis (Missouri).
S’appuyant sur des documents inédits, des témoignages de victimes, de scientifiques ou d’hommes politiques, le livre reconstitue la genèse d’un empire industriel, qui, à grand renfort de rapports mensongers, de collusion avec l’administration nord-américaine, de pressions et tentatives de corruption, est devenu le premier semencier du monde.
Et il révèle notamment le rôle joué par Monsanto dans le formidable tour de passe-passe qui a permis l’extension planétaire des cultures OGM sans aucun contrôle sérieux de leurs effets sur la nature et la santé humaine.
Pour en savoir plus sur cet ouvrage
Pour en savoir plus sur le documentaire filmé de Marie-Monique Robin, rendez-vous sur le site de Rue89 et l’article d’Ophélie Neiman. Vous pourrez y lire des extraits de l’ouvrage, regarder la bande-annonce du documentaire qui a été diffusé sur Arte le 11 mars 2008 ainsi qu’une interview de l’auteur.
Découvrez le blog de Marie-Monique Robin
Enfin, plusieurs ONG (Attac France, Greenpeace, les Amis de la Terre, Via Campesina, Fondation Sciences citoyennes, Sherpa, Inf'OGM) ont construit ensemble le site www.combat-monsanto.org, qui a pour vocation de relayer et de diffuser les informations révélées par l’enquête de Marie-Monique Robin. ![]()
50 ans de combat du Planning pour les droits des femmes
Le 8 mars 2006, le Planning familial fête ses cinquante ans. Si ce nom ne dit peut-être rien à certains éléments de la gent masculine, il en revanche beaucoup plus connu de l’autre sexe : nombreuses sont en effet celles qui en ont entendu parler, au moment de l’adolescence, quand elles se demandaient comment et où se procurer la pilule...
Depuis ses débuts en 1956, sous le nom pacifique de « Maternité heureuse », le Mouvement français pour le Planning familial n’a cessé de batailler pour les droits des femmes à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et plus largement à la libre sexualité. En un demi-siècle, cette lutte a bouleversé la société française, et la vie des femmes en particulier. La conquête de ces droits n’a pas été sans heurts et parmi les ennemis à la dent dure du Planning, on compte toujours le sexisme, le machisme et la misogynie mais aussi la violence conjugale, l’homophobie, l’intégrisme… Loin d’être terminé, le combat se poursuit aujourd’hui pour prévenir un retour à l’ « ordre moral », face à l’empreinte de plus en plus marquée du néoconservatisme.
C’est cette histoire d’une lutte évolutive que relate cet ouvrage. Une large place y est faite à la parole des militantes, qui nous font vivre les moments forts du Mouvement, ses actions mais aussi ses doutes et ses dissensions : des avortements clandestins pratiqués à ses débuts aux actions internationales actuelles, en passant par la loi Neuwirth légalisant la contraception, Mai 68, la loi Veil sur l’avortement… c’est une véritable traversée de la seconde moitié du XXe siècle qui nous est offerte ici, sous forme de fresque voire d’épopée.
Téléchargez la préface de l'ouvrage ici.
François Gèze
Appel pour les Assises de l’anticolonialisme postcolonial », celles et ceux qui se sont autodésignés comme « indigènes de la République » ont posé une petite bombe. Leur texte commence par un constat aussi brutal que lucide : « Discriminées à l’embauche, au logement, à la santé, à l’école et aux loisirs, les personnes issues des colonies, anciennes ou actuelles, et de l’immigration postcoloniale sont les premières victimes de l’exclusion sociale et de la précarisation. »
Cet appel a provoqué dans les mois suivants un véritable tohu-bohu médiatique, le plus souvent critique, sur le thème : les discriminations raciales sont « bien réelles », mais ce texte n’est rien d’autre qu’un appel au « communautarisme », sûrement sous-tendu d’antisionisme, voire d’antisémitisme. Et pourtant, fait extraordinaire, dans le même temps, nos médias « politiquement corrects » ont consacré pour la première fois des pages entières aux massacres du Constantinois en mai-juin 1945, tragédie occultée de l’histoire coloniale et fort justement mise en avant par l’Appel des indigènes.
Au-delà de certaines formules maladroites, ce texte a en effet mis le doigt sur une réalité qu’il devient de plus en plus difficile de nier : la persistance des discriminations racistes à l’encontre des Français et étrangers « colorés » s’explique largement par la « fracture coloniale ». L’histoire de la République est en effet indissociable d’un déni de l’Autre « indigène », parfaitement contradictoire avec ses valeurs fondatrices, et qui justifia les pires horreurs. Un déni jamais reconnu depuis les indépendances, et qui perdure aujourd’hui, avec l’encouragement de prétendus « défenseurs de la République », qui en seraient plutôt les fossoyeurs...
C’est ce que montre notamment une étonnante enquête sur la perception du fait colonial, conduite à Toulouse en 2003 par les historiens de l’ACHAC (Association Connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine), Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Emmanuelle Collignon et Sandrine Lemaire. Cette enquête révèle à la fois une grande méconnaissance des événements précis qui ont marqué l’histoire coloniale, et un sentiment très fort que cette histoire joue pourtant un grand rôle dans les discriminations dont sont actuellement l’objet les descendants des « indigènes » de la première (Antilles) et de la seconde (Afrique, Maghreb, Indochine) colonisation française. Et une très forte majorité des enquêtés estime qu’une meilleure connaissance de l’histoire coloniale et de ses pages noires, notamment grâce à l’enseignement scolaire, pourrait contribuer à une meilleure « intégration » de ces populations.
D’où l’importance de l’ouvrage collectif La Fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial, que nous publions en cette rentrée : conçu (bien avant le lancement de l’Appel des indigènes) et dirigé par Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, cet ouvrage présente une synthèse de la passionnante enquête de Toulouse et, surtout, réunit une vingtaine de contributions originales de chercheurs (historiens, sociologues, politologues…) et militants sur les origines et les manifestations contemporaines de la fracture coloniale.
Pascal Blanchard et Nicolas Bancel y expliquent notamment comment le colonialisme promu par la IIIe République a installé, au rebours de ses valeurs affichées, « l’inégalitarisme racial au cœur du dispositif républicain colonial ». Faute d’avoir jamais été reconnu comme tel, c’est bien cet « inégalitarisme racial » qui perdure aujourd’hui, à bas bruit, au sein de la société française, comment le montrent les auteurs de La fracture coloniale. Rédigé et pensé pour être accessible au plus large public, notre souhait et que ce livre puisse contribuer aux débats nécessaires pour construire une histoire de la République n’ignorant plus ses « pages noires », afin que tous ceux qui l’habitent aujourd’hui puissent partager un récit réconcilié, où les « indigènes » et leurs descendants auront enfin toute leur place.
Dans la même perspective, nous publions en cet automne le livre important de Caroline Oudin-Bastide, Travail, capitalisme et société esclavagiste. Guadeloupe, Martinique (XVIe-XIXe siècle), où l’auteur, au carrefour de l’histoire économique et de l’anthropologie historique, dresse un portrait original et saisissant de la société esclavagiste des Antilles françaises.
Un travail qui sera utilement complété, en novembre, par la publication dans notre collection de poche « Sur le vif », du rapport au Premier ministre du Comité pour la mémoire de l’esclavage.
François Gèze, PDG des Éditions La Découverte.