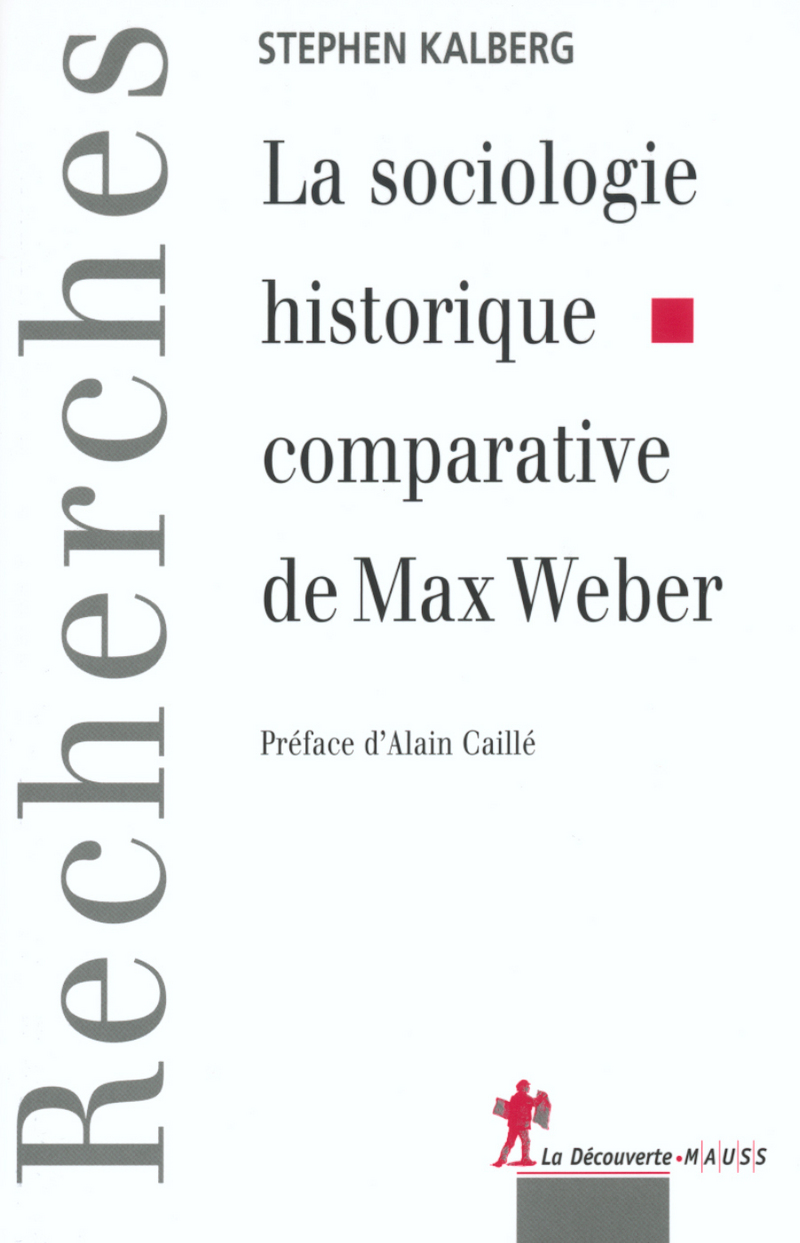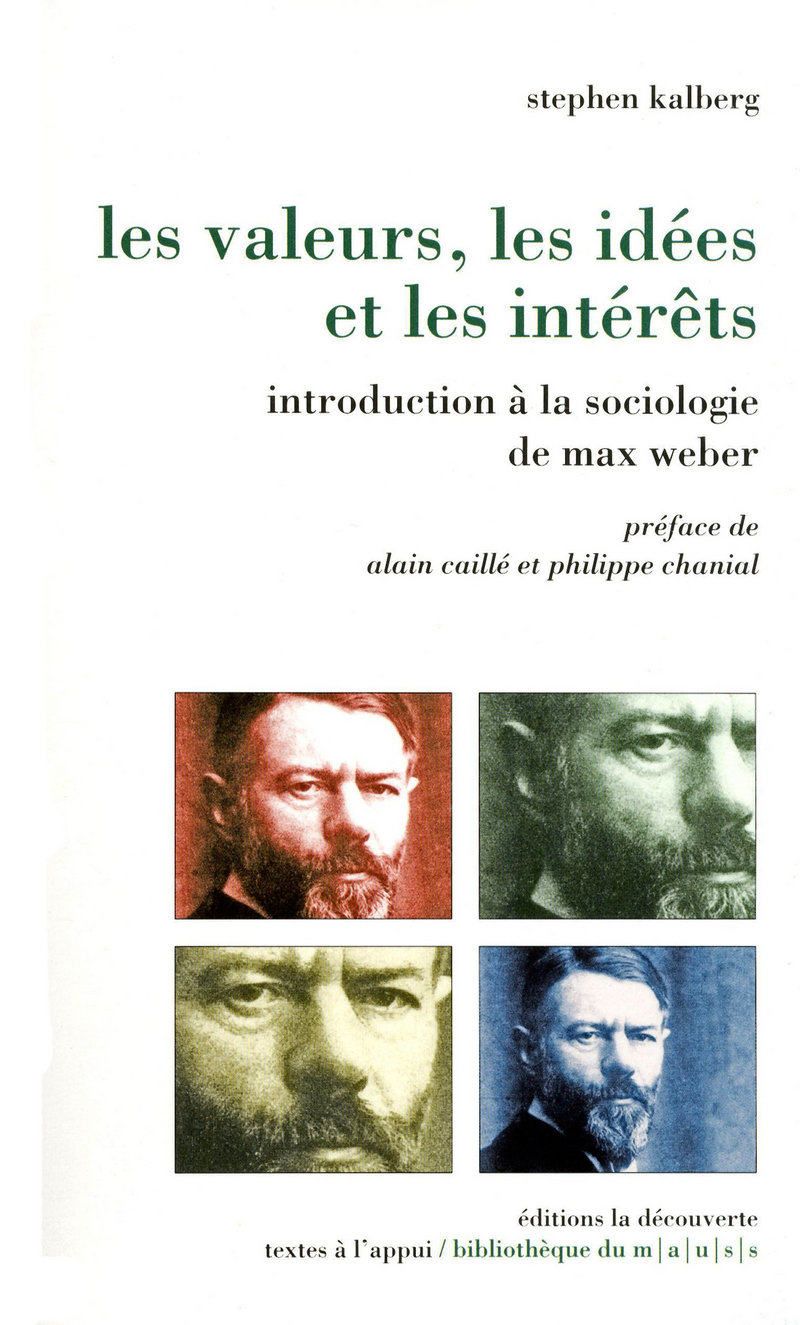La sociologie historique comparative de Max Weber
Stephen Kalberg
Max Weber, le plus fameux de tous les sociologues, est aussi le plus mal connu. Et pas seulement en France, où la dispersion des traductions rend difficile la saisie d'ensemble de son œuvre. En fait, là comme ailleurs, on croit connaître assez bien le Weber philosophe social, relativiste et pessimiste, le prophète de malheur qui assimile la modernité à une " cage de fer ". Mais on n'a encore qu'une bien faible idée de la puissance proprement sociologique et historique de ses études qui, sur la base d'une conceptualisation d'une ampleur sans équivalent, embrassent toutes les grandes religions sous l'angle des rapports étonnamment complexes qu'elles entretiennent avec l'économie, le pouvoir et la vie pratique. C'est cette sociologie historique, systématique et rigoureuse, que Stephen Kalberg reconstitue pas à pas, avec clarté et précision, en la comparant avec les sociologies historiques contemporaines des Bendix, Tilly, Skocpol, Wallerstein, etc. Et très vite, il nous convainc de la supériorité méthodologique de la démarche de Weber. À le lire, la conclusion s'impose d'elle-même : la sociologie historique est wébérienne ou elle n'est pas.

Nb de pages : 284
Dimensions : * cm
 Stephen Kalberg
Stephen Kalberg

Table des matières 

Max Weber, notre contemporain si méconnu, préface par Alain Caillé
Note technique sur la traduction, par Alain Caillé
Remerciements
Liste des abréviations
Introduction
La sociologie historique comparative aujourd'hui
La théorie des systèmes-monde
L'approche interprétative-historique
L'approche causale-analytique
Dilemmes et problèmes : les apports de Weber
Les modes d'articulation entre l'action et la structure
La multicausalité
Le niveau de l'analyse : théorie générale versus problèmes délimités
La construction de modèles
Le mode d'analyse causale
La littérature secondaire ou la renaissance wébérienne
Première partie : les fondements de la sociologie historique comparative wébérienne
1. Les modes d'articulation entre l'action et la structure : le pluralisme des motifs et le structuralisme de Weber
L'individualisme méthodologique, le Verstehen, les quatre types d'action sociale et le pluralisme des motifs
L'action et la structure : les modes de configuration de l'action
Régularités ordonnées et régularités ordonnées légitimes
Une sociologie contextuelle : les loci sociologiques de l'action : guerriers et couches urbaines, famille et voisinage, le pouvoir féodal
Les modes d'articulation entre l'action et la structure
2. La multicausalité chez Weber
Un engagement de principe en faveur de la multicausalité
Les porteurs sociaux
L'intensité variable de l'action et l'opposition à la théorie du choix rationnel
Les évènements historiques, la technologie et la géographie
La puissance, le conflit et la concurrence
La puissance
Le conflit et la concurrence
Seconde partie : À la recherche de la causalité, stratégies et procédures
3. Le niveau de l'analyse : l'idéal-type
L'objet de l'analyse causale
L'idéal-type
Les idéal-types : construction et caractéristiques principales
La réalité à l'" aune " des idéal-types : la définition des cas empiriques
4. Les idéal-types comme modèles générateurs d'hypothèses
Les idéal-types comme modèles dynamiques
La bureaucratie
Le patrimonialisme
Les modèles idéal-typiques contextuels
Les relations analytiques : les modèles d'affinité et d'antagonisme
Les modèles de relations d'antagonisme intra-domaines
Les modèles d'affinité et d'antagonisme inter-domaines : religion et groupes de statut, l'antagonisme entre le pouvoir charismatique et l'économie rationnelle, les organisations universelles : leurs relations avec l'économie et la religion
Les modèles de développement
Les modèles de développement fondés sur les intérêts : la clôture des relations sociales et la routinisation du charisme : la clôture des relations sociales et la monopolisation des opportunités, le modèle de la routinisation du charisme
Les modèles de développement fondés sur des processus de rationalisation ; les modèles de rationalisation formelle et théorique : les modèles de développement de la rationalisation formelle : le marché et l'État, les modèles de développement de la rationalisation théorique : la religion
5. L'analyse causale reconstruite : méthodologie causale et cadre théorique
Le mode d'analyse causale : vue d'ensemble et comparaison avec les écoles contemporaines
La méthodologie causale
Le cadre théorique : domaines et idéal-types spécifiques de domaines
Méthodologie et cadre théorique de l'analyse causale wébérienne
Les degrés de causalité : la comparaison comme outil de la distinction entre les orientations " facilitantes " ou " nécessaires " de l'action
Les domaines sociétaux et les interactions synchroniques et diachroniques de l'action : l'interaction synchronique, l'échelle d'incidence , l'interaction diachronique : legs et conditions antécédentes, interactions intra-domaines de type " legs ", interactions inter-domainesde type " legs ", l'échelle d'incidence, interactions intra-domaines de type " conditions antécédentes ", interactions inter-domaines de type " conditions antécédentes "
L'interaction conjoncturelle et le contexte de l'action configurée : l'essor du monothéisme, l'essor d'une conception impersonnelle du surnaturel en Inde, l'essor du confucianisme
Une illustration : la prédominance du système des castes en Inde
Les degrés de centralité causale : les facteurs facilitants, les orientations nécessaires de l'action : le charisme de clan, la couche porteuse : les brahmanes, la religion : les doctrines du karman et du samsara de l'hindouisme classique, la Restauration hindoue, les transformations de la forme organisationnelle de l'hindouisme
Les interactions synchroniques et diachroniques de l'action
L'interaction synchronique
L'interaction diachronique : les legs
Les interactions conjoncturelles de l'action
Conclusion
La sociologie historique comparative de Max Weber et les écoles sociologiques contemporaines
Vue d'ensemble
Perspectives de recherche
Bibliographie
Index thématique.