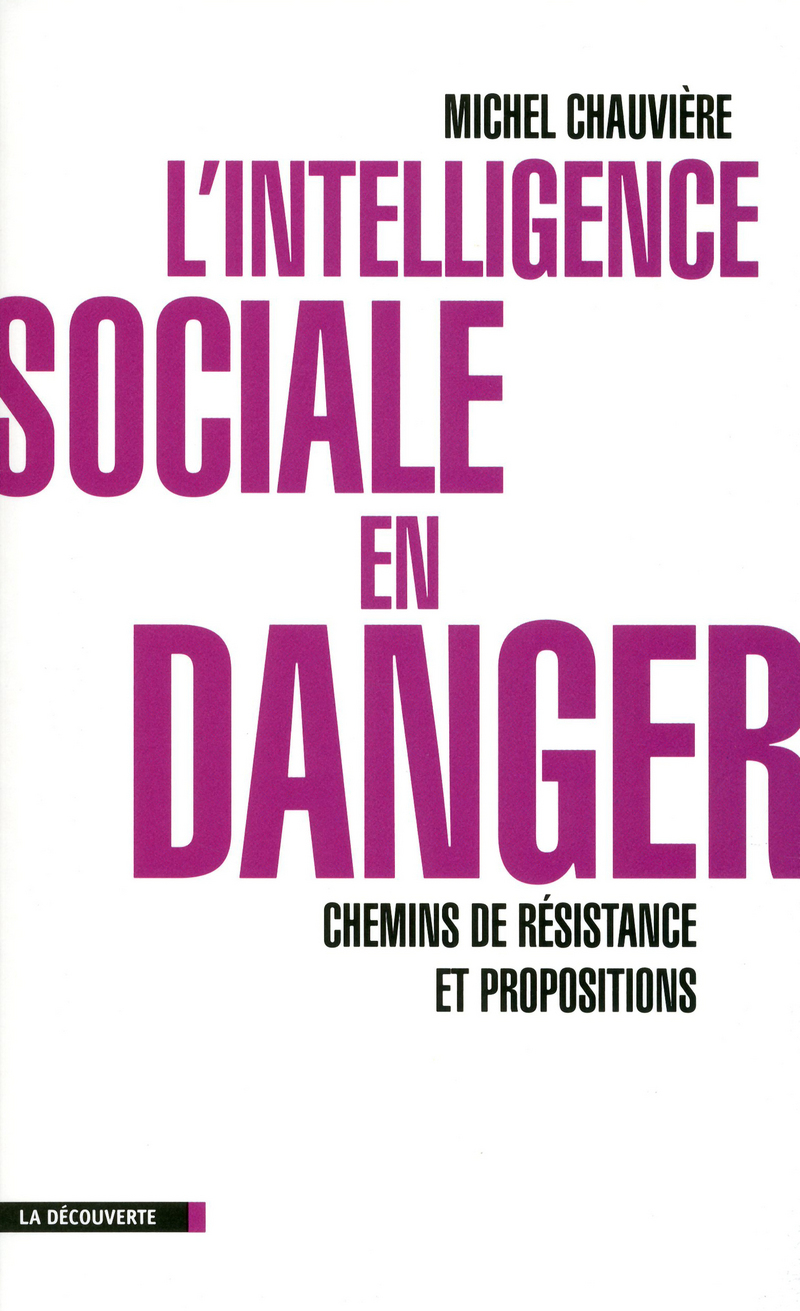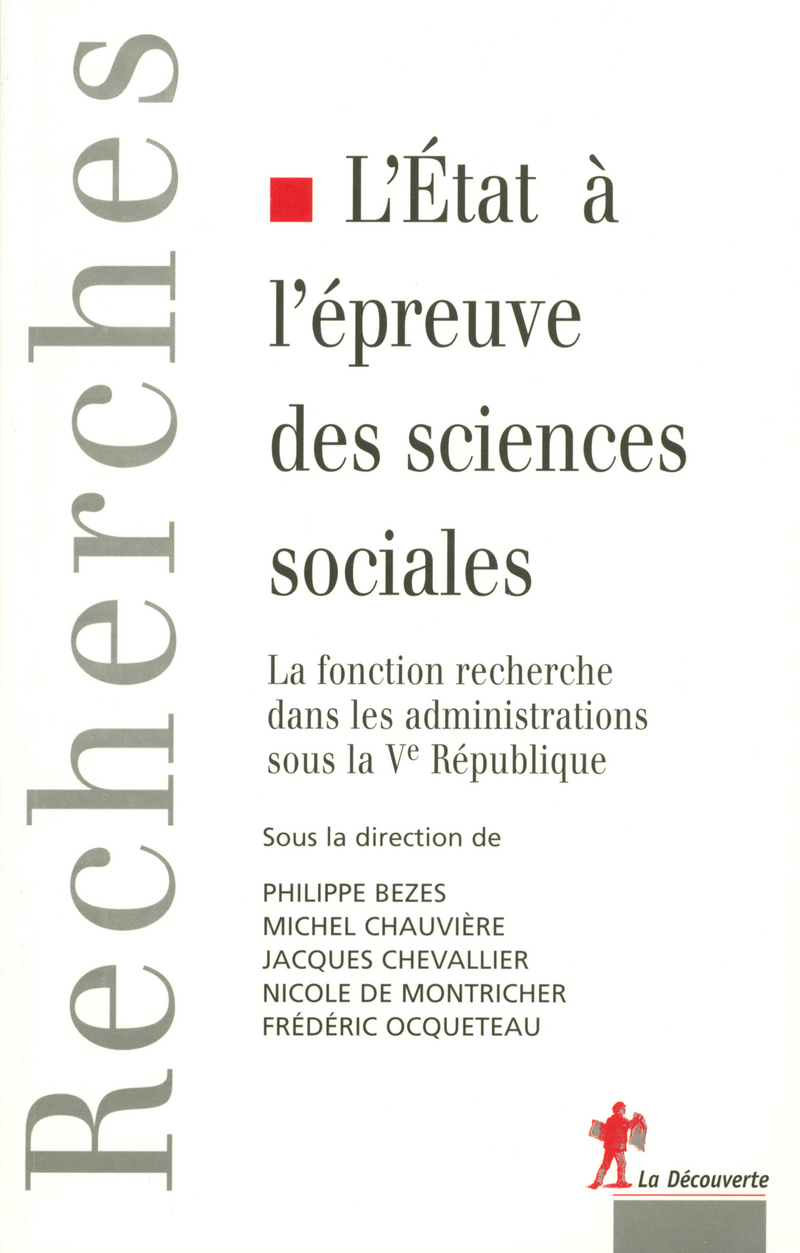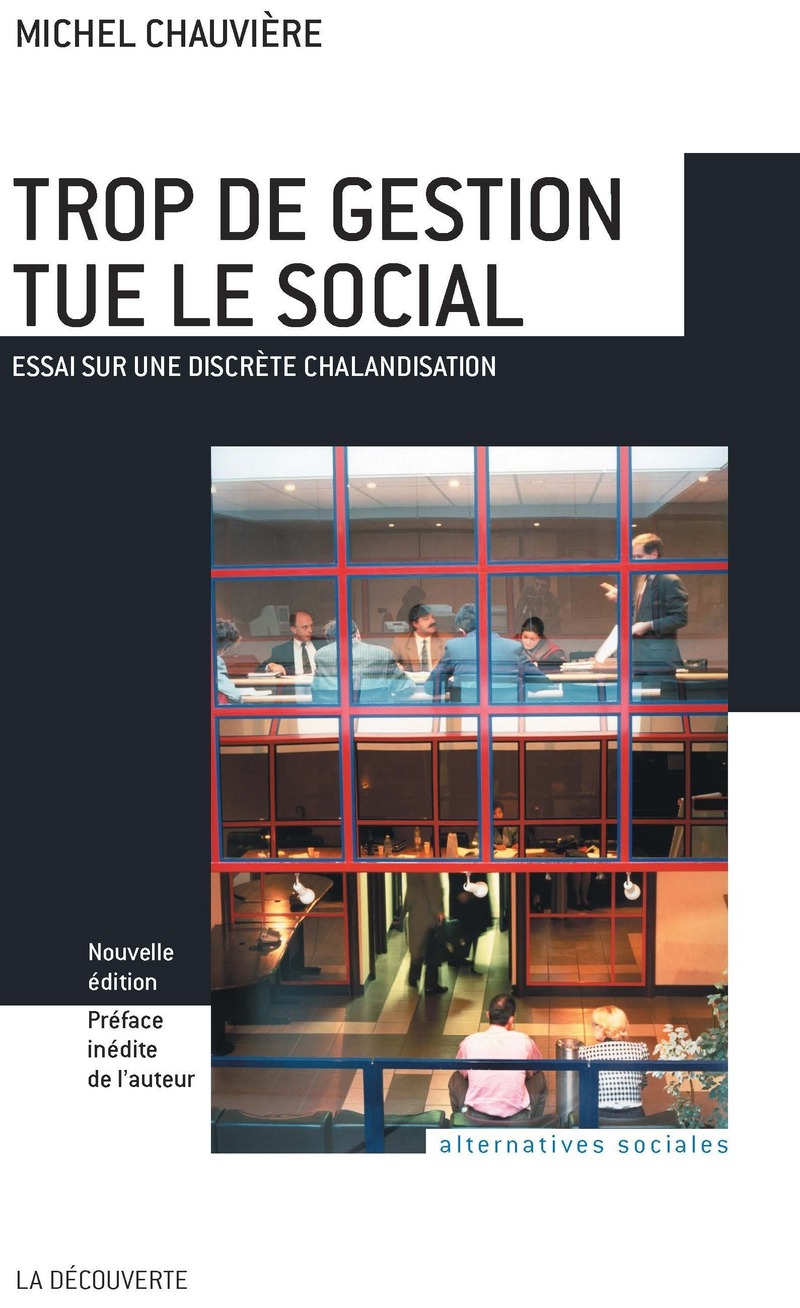L'intelligence sociale en danger
Chemins de résistance et propositions
Michel Chauvière
Au cours du XXe siècle, un modèle social s'est imposé en France au prix de luttes parfois dures et longues. Beaucoup d'intelligence et de pugnacité ont été nécessaires pour penser et mettre en œuvre une architecture pertinente, à la hauteur des enjeux. Celle-ci repose notamment sur quatre principaux registres interdépendants : les droits, les institutions, les savoirs et les actes de métier.
Or les politiques mises en œuvre ces dernières années opèrent une dislocation de ces différents registres, au nom du pragmatisme, de l'individualisation ou de la performance. En outre, la recherche effrénée d'économies s'accompagne d'un lot de publicités mensongères (qualité, libre choix, droit opposable...). Un intense travail de remise en cause des représentations du social et des valeurs de solidarité est passé par là, contribuant à affaiblir les pratiques de terrain et la culture politique propres au champ social, malgré la remontée préoccupante des inégalités. Comment y résister collectivement ?
Poursuivant la réflexion entamée dans Trop de gestion tue le social (La Découverte, nouvelle éd. 2010), Michel Chauvière montre ici que notre héritage juridique, institutionnel, cognitif et professionnel, loin d'être la cause d'inutiles dépenses publiques et d'un assistanat chronique, constitue au contraire une ressource incontournable pour apporter une réponse solidaire et globale à la question sociale qui nous interpelle tous.

Nb de pages : 272
Dimensions : * cm
ISBN numérique : 9782707170897
 Michel Chauvière
Michel Chauvière

Michel Chauvière est directeur de recherche au CNRS, membre du CERSA, CNRS/université de Paris-2. Ses travaux portent sur les politiques du social et du familial. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment Le Travail social dans l'action publique. Sociologie d'une qualification controversée (Dunod, 2004), et il a codirigé avec Jean-Michel Belorgey et Jacques Ladsous, Reconstruire l'action sociale (Dunod, 2006).
Extraits presse 

Vivons-nous la fin de la "philosophie politique de la solidarité nationale" ? C'est en tout cas la crainte que Michel Chauvière exprime dans ce livre. Dans son précédent essai, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation (La Découverte, 2010), le directeur de recherche au CNRS montrait comment le lexique de l'entreprise a progressivement envahi la société tout entière. Il y analysait la "chalandisation" des rapports sociaux, c'est-à-dire la métamorphose des représentations qui fait de nous de plus en plus des clients de l'Etat, et de moins en moins des citoyens. Dans ce nouvel opus, sous-titré Chemins de résistance et propositions, Michel Chauvière montre comment notre "intelligence sociale", c'est-à-dire l'ensemble des représentations, des valeurs, des pratiques, qui forment en grande partie notre culture politique, s'est construite sur quatre piliers : les institutions, le droit, les savoirs, et les savoir-faire. Or ces quatre fondements sont aujourd'hui attaqués, estime le sociologue. On privatise les services publics ; on revient sur un certain nombre de droits fondamentaux ; on fait la chasse aux savoirs non rentables ; on casse les solidarités professionnelles. C'est à une "mise en crise délibérée des modèles sociaux établis" que l'on assiste en Europe occidentale, estime Michel Chauvière, pour qui "loin de se moraliser, le capitalisme se radicalise". Et qui avertit : "La coupe est pleine." D'aucuns pourront trouver le propos exagéré, à l'heure où la dépense publique, en France, représente 56 % du produit intérieur brut. C'est peut-être quand l'auteur dénonce le vertige de l'évaluation à tous crins qu'il reste le plus convaincant. "Nous sommes passés en quelques années du souci de valorisation à l'impératif d'évaluation", écrit-il. L'évaluation s'impose désormais comme unique morale publique, ironise M. Chauvière, en dénonçant une "approche mécanique du social". Son essai pose néanmoins une question fondamentale : comment, en période de vaches maigres, apporter une réponse à la question sociale, qui continue de nous interpeller.
2012-01-09 - Philippe Arnaud - Le Monde Economie
Table des matières 

Introduction
Canal historique
Le grand écart
Récurrence de la question sociale
L'exigence d'un projet politique
1. S'appuyer sur l'État de droit social
De quoi la constitutionnalité du social est-elle le nom ?
Les transformations de l'action publique - Essai de classement - L'échec de l'évaluation démocratique des politiques publiques ?
L'action collective n'est pas un algorithme
Un nouveau rapport au monde et à l'action collective - Le social dans la tenaille - Le cumul des effets pervers
Renflouer le service public d'action sociale
Sous l'effet de la LOLF et de la RGPP - Significations d'un changement de référentiel - Nécessité d'un service public
2. Consolider nos accords pour l'action collective
Deux exemples récents de dégradation
La fin du cycle de l'intérêt de l'enfant - Après cinquante ans de service, le médico-social à la trappe
Le social à l'épreuve de la décentralisation des compétences
Un social dévitalisé - Opérateurs/employeurs et agences en hausse, métiers à la baisse
Redonner sens au moment juridique
Rappeler les droits de l'homme, mais aussi l'État de droit - Le contrat organise, mais ne garantit pas la solidarité
3. Affirmer et affermir l'approche institutionnelle
Qui a peur des institutions ?
Institutions, organisations, entreprises - Les institutions sociales à l'épreuve de la construction européenne - Pour une activité non économique et d'intérêt général
Contrer le déclassement du monde associatif
Les associations, acteurs collectifs et baromètres de la démocratie - Sortir de la double contrainte - Quel printemps pour les associations gestionnaires ? - Institutions et dispositifs
4. Soutenir les professions et la démocratie sociale
Résister à l'insidieuse déprofessionnalisation
Penser la question des professions - Protéger les champs professionnels au niveau territorial - Respecter les praticiens et leur collégialité - Défense et illustration du conventionnel
Politiser l'usage des services contre le consumérisme ambiant
Questionner l'usager - Généalogie des rapports sociaux d'usage - Soutenir les usagers citoyens
5. Restaurer les deux piliers du savoir social : la recherche et la formation
Affronter la question de la recherche
La recherche scientifique et le travail social - Retour sur quelques tentatives de structuration - Un champ, pas une discipline - De quelques fondamentaux pour toute recherche - Propositions pour une recherche critique
Formation cherche politique substantielle
Une professionnalisation en berne - Ce qui se passe dans un centre de formation - Ce qui se dit dans les cénacles - Faut-il croire aux Hautes écoles de travail social ? - Libérer la formation
6. Actes de métier cliniques contre bonnes pratiques
Extension et crise de la clinique
La révolution clinique - L'acte contre les instruments - Ambiguïtés et contradictions du care
Défier le piège de l'évaluation des pratiques
L'évaluation comme déni et déplacement du social en actes - La folie évaluative dans le secteur social
Conclusion
Un autre chemin de modernisation reste possible
Propositions
1. Veiller à l'effectivité des droits et aller vers de nouvelles protections sociales - 2. Les politiques publiques dédiées impliquent des compromis durables - 3. Réveiller la pensée institutionnelle - 4. Réarmer l'esprit de service public jusqu'au sein des associations délégataires - 5. Que vivent les métiers et que soient respectées les professions - 6. Politiser les usages, parier sur la citoyenneté des usagers - 7. Le savoir est vivant, la bataille des mots est décisive - 8. Que renaisse l'espace-temps de la formation - 9. Respect pour le trièdre de la clinique - 10. Déjouer le piège évaluatif par la voie démocratique - 11. Relégitimer l'action sociale et le travail social à visage humain
Annexes
1. Chrnologies du médico-social en France, hors sécurité sociale
2. Principaux sigles utilisés
3. Bibliographie complémentaire .